
Interview
Le titre de votre pièce, Monde nouveau, résonne aujourd’hui de manière assez spectaculaire. Rarement, en effet, a-t-on eu autant l’impression de vivre dans un monde aussi nouveau. Le spectacle que vous créez pour ce Printemps des comédiens va-t-il évoquer cette actualité internationale si mouvementée ou parle-t-il d’autre chose ?
Oui, mais de façon plus lointaine que strictement collée à l’actualité qui, de toute façon va à une vitesse telle que l’idée n’est pas d’essayer de lui courir après. En fait, il est question de cette injonction à la nouveauté, sous les formes diverses d’innovation qu’on a pu connaître. Et ça va de ce qu’on a appelé la nouvelle économie dans les années 80, aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, etc. Cette injonction à la nouveauté laisse déjà penser, idéologiquement, à une espèce de révolution d’ordre pratiquement anthropologique, comme si on était entré dans une nouvelle ère.
Des ruptures notamment technologiques, il y en a depuis que le monde est monde. Chaque décennie dernièrement, certes, mais en quoi cela est-il nouveau précisément ?
Dans la forme nouvelle qu’a pris ce qui a démarré de façon claire, nette et offensive dans les années 80, c’est-à-dire un néo, le néo du néolibéralisme en fait. Il s’est appuyé sur une espèce de machine à appeler et à générer de la nouveauté, presque d’heure en heure. Le point de départ de la pièce est plutôt cette injonction à la nouveauté de façon permanente et offensive qui produit à peu près à tous les étages de l’existence, dans nos jours et dans nos nuits, un rythme ou une espèce de course en avant, dans laquelle on pourrait dire que l’humanité s’engouffre. C’est le point de départ. L’idée que l’on devait essayer de donner une forme théâtrale à cette nouveauté-là.

Quelle forme avez-vous donc choisi de donner à votre pièce ?
Juste à titre de comparaison, parce que c’est vrai qu’il y a toujours eu des nouveautés dans le temps, on avait en tête Les temps modernes de Charlie Chaplin. Ce n’est pas du tout la forme que ça va prendre finalement, mais on se disait qu’il y avait aussi une nouveauté, le travail à la chaîne. Et on voyait très clairement un représentant de l’espèce humaine accroché à une machine qui lui faisait faire ce qu’elle voulait, à ce moment-là de l’Histoire. C’est donc moins une pièce d’actualité au sens strict, qu’une sorte de farce anthropologique – c’est comme ça qu’on a appelé la pièce au début. Le terme est savant, mais c’était quelque chose de cet ordre, au plus près du contemporain, à l’échelle de l’espèce humaine, où il y a des mutations très fortes et où, aussi, la question de l’espèce se pose en tant que telle, puisque cette vitesse et cette course en avant installent dans les esprits non seulement l’idée d’un monde nouveau mais possiblement d’une fin du monde.
Vous avez puisé dans d’autres registres ?
J’ai pensé aussi aux Tweedledum et Tweedledee de Alice au pays des merveilles, ces jumeaux un peu grotesques qui se jouent entre eux d’une espèce de logique un peu absurde, mais qui mouline, mouline, mouline du discours jusqu’à ce que… Bref, on s’est dit en pensant aussi à Brecht – qui s’interrogeait sur ce qu’était de jouer du théâtre à l’ère scientifique*– qu’est-ce que cela pouvait donner une manière de faire du théâtre, à l’ère du numérique, des algorithmes ? Comment cette idée guide les acteurs, actrices, sur un plateau de théâtre ? C’est ce qui nous a intéressés.
Comment le contexte institutionnel, aussi, formate nos faits et gestes ?
Oui, absolument, mais au sens large bien sûr. Ce ne sont pas les institutions qui donnent des directives si formulées que ça, mais comment la vie des êtres humains entre eux s’institue, est travaillée… Est-ce que le téléphone que je tiens dans les mains est une institution ? Je pense que oui. Il institue une forme de parole ; ça passe aussi par l’écran… Ça régit d’une certaine manière notre façon de nous parler de nous aimer, de se gouverner, etc.
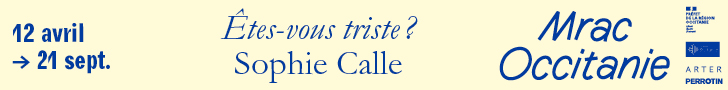
Votre pièce est-elle aussi une vision du théâtre sur le théâtre ?
Non. Au début de la pièce, il y a une femme qui est un peu extérieure à tout ça, prise dans un certain nombre d’événements. Je ne peux pas en dire plus mais, disons qu’elle va accompagner ces événements. Selon un fonctionnement extrêmement rapide – et ça marche – ou alors non, et la machine s’emballe […] les choses se mettent à chanceler. Ça finit par un procès à la Alice au pays des merveilles, celui de cette femme, parmi les agents de cette machine. Voilà à gros traits la trame. Il y a une phrase de Kafka que j’adore qui dit qu’il faudrait que l’art soit moins un miroir qu’une montre qui avance. Eh bien, cette montre qui avance, le retard qu’on prend et la précipitation que ça engendre… on s’est dit qu’il ne fallait pas qu’on reste sur une représentation formalisé du temps présent. Il fallait qu’on arrive à emballer la machine. Il y a une déclaration de guerre, des éléments très concrets avec une machine très abstraite.
On rit beaucoup, semble-t-il, malgré le sujet ?
Oui. Ce n’est pas la fonction du théâtre que de nous écraser avec ce qu’on sait déjà, mais on peut prendre appui sur des troubles qui nous traversent, dépasser le temps présent – qui a bien des raisons de nous déprimer – pour trouver un souffle, se donner la liberté de la farce. La farce a cette fonction de s’emparer des éléments du monde qui nous entoure, de les faire tourbillonner à une autre vitesse que celle habituelle, pour en montrer autre chose. Ça demande des efforts surhumains par les temps qui courent (rire), mais c’est l’idée.
Êtes-vous sûr que la toute dernière actualité ne trouvera pas une petite place d’ici à ce que la pièce soit montée ?
Non. Ou, peut-être, à un moment de la pièce. On a des sortes de marionnettes vivantes, un discours à trois têtes : Trump, Meloni et Milei, dans une courte conférence de presse… Mais c’est très court.
À propos d’actualité, alors qu’on a créé la cité européenne du théâtre à Montpellier, le Printemps des comédiens semble mal en point, financièrement. De manière plus générale, la culture aussi. Quel impact cela a sur votre travail ?
Pour l’instant, on est dans l’incertitude, comme tout le monde, ce qui fait des conditions de travail disons particulières. Sans qu’on sache les tenants et les aboutissements des décisions.
Ces tensions autour de la Culture, y compris dans l’Hérault où l’on ne s’y attendait pas, c’est inquiétant, non ?
Oui, bien sûr… On travaille en parallèle sur une pièce d’Antonio Gramsci, connu pour des questions de guerre culturelles. Et on constate, en effet, que sur ce terrain, il y a une offensive sans nom, extrêmement brutale, telle qu’on n’a jamais connue. Les attaques sont directes.
• Avec Florian Onnéin, Conchita Paz, Lorie-Joy Ramanaïdou, Charly Totterwitz (troupe associée au Théâtre des 13 vents) et Eléna Doratiotto, Mitsou Doudeau, Jules Puibaraud / Cédric Michel (en alternance)
• En tournée notamment à Albi, Alès et Sète
* Mouvement du théâtre épique qui s’est développé dans la première moitié du XX e siècle, à partir de théories et d’expériences d’un certain nombre de personnalités du théâtre.
Légendes :
– Photos de répétitions © Jean-Louis Fernandez










