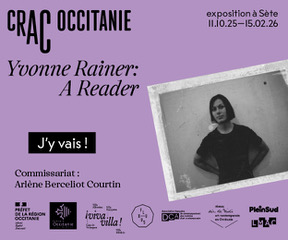Selon les toutes premières lignes du code de l’Éducation nationale, l’école concourt « à l’éducation à la responsabilité civique […] et participe à la prévention de la délinquance ». En réalité, l’institution scolaire ne se montrerait que peu glorieuse en la matière ! Son pouvoir disciplinaire serait au contraire abusif et exclurait « massivement », laissant de nombreux jeunes déscolarisés, livrés à eux-mêmes et plus vulnérables à la délinquance. C’est en tout cas le constat qu’établissait en 2017 la magistrate Alexandrine Vieitez, ancienne présidente de l’association L’avocat et l’enfant, dans un article publié dans le Journal du droit des jeunes : Le pouvoir disciplinaire en milieu scolaire, un pourvoyeur de délinquance juvénile ? Il est issu d’un mémoire dans le cadre d’un master métier de l’enseignement de l’éducation et de la formation.
À la rentrée 2025 et à l’aune de l’actualité, artdeville l’a relu. La thèse de Maître Vieitez ? Un système disciplinaire scolaire inéquitable et centralisé, dans lequel le chef d’établissement dispose de « pouvoirs exorbitants ».
Il initie, instruit et sanctionne les fautes, souvent hors de la convocation d’un conseil de discipline, et sans respect pour la notion de proportionnalité de la sanction (avertissement, blâme). Très vite l’exclusion définitive est prononcée, en une procédure verticale, rarement contradictoire et difficilement contestable juridiquement. Pour Me Vieitez, cette situation étant statistiquement la plus fréquente, « l’élève, de fait, perd son droit à l’assistance d’un avocat, et ce en totale violation de la Convention européenne des droits de l’homme. »
À l’inverse de ses objectifs, l’Éducation nationale serait ainsi régie par un « pouvoir disciplinaire et non pas de droit disciplinaire » et « dans un rapport de force imposé par le dominant sur le dominé. »
En totale contradiction, en somme, avec ce qui fonde une responsabilité civique, une démocratie.
Interview
« Il faut éduquer à la sanction »
Dans cet article, vous n’y allez pas de main morte : c’est un échec total de l’Éducation nationale que vous décrivez ! Est-elle vraiment un pourvoyeur de délinquance juvénile ?
C’était une interrogation, pas une affirmation.
Certes, mais votre démonstration ne laisse guère de place au doute.
Le travail que j’ai mené à l’époque était de comparer les sanctions prises à l’école avec celles qui peuvent être prises par la justice lorsqu’un mineur transgresse la loi, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires. Ce qui était très clair, c’était le contraste : l’école excluait souvent, en tout cas, arrivait souvent à la sanction maximale qu’est l’exclusion de l’établissement scolaire. Or, nous, la Justice, dans les sanctions que nous prononçons à l’encontre des mineurs, il y a des obligations de scolarisation. Je trouvais – et je trouve toujours – qu’il y a un paradoxe entre les deux. Lorsque je pose la question de l’Éducation nationale pourvoyeur de délinquance, c’est parce qu’on constate, nous, du côté de la Justice, que malheureusement la plupart des délits commis par des mineurs sont réalisés par des mineurs qui sont déscolarisés ou en décrochage scolaire.
J’ai donc essayé de réfléchir et d’alerter ; les mineurs sont censés être scolarisés. On dit que l’école est la société des enfants. Or, à un moment donné, ils se retrouvent hors de l’école, hors des murs, à la rue. Et c’est à ce moment-là qu’il peut y avoir des passages à l’acte qui plongent ces jeunes dans la délinquance.
A priori, il n’est pas de parti politique qui ne place l’Éducation nationale comme priorité pour bâtir le monde de demain. Or les bases démocratiques sur lesquelles on s’attend à ce que ce monde de demain puisse s’établir sont défaillantes : la verticalité, le caractère solitaire de ce pouvoir disciplinaire que vous décrivez… c’est effrayant !
Je ne dirais pas que l’Éducation nationale est défaillante.
Tout de même, son fonctionnement…
Je dirais plutôt qu’il faut éduquer à la sanction, à quoi sert la sanction. Mon travail de réflexion est plutôt sur ça. Les transgressions au règlement dans les établissements scolaires existent, donc iI est évident qu’il doit y avoir des sanctions. Mais je pose la question de la légitimité de l’exclusion scolaire.
Depuis 2017, l’année où vous avez écrit ce mémoire, avez-vous constaté des améliorations ?
En tout cas, les avocats ont pu rentrer dans les conseils de discipline, donc les mineurs sont de plus en plus assistés lors des conseils de discipline. C’est une mesure qui était déjà en place en 2017 et c’est quelque chose qui s’est multiplié. Les familles ont eu l’information. Après, je n’ai aucune statistique pour comparer.
Reste qu’en démocratie, outre le contradictoire, la séparation des pouvoirs est essentielle. Or, dans un conseil de discipline, le directeur d’établissement est toujours juge et partie. Vous parlez même d’un pouvoir exorbitant…
C’est toute la subtilité du droit disciplinaire, qui est le même que dans n’importe quelle instance disciplinaire [comme l’entreprise, par exemple – NDLR] et n’est pas lié exclusivement à l’Éducation nationale. Il est indépendant du droit classique. C’est de par la loi que les chefs d’établissement scolaires ont ces pouvoirs.
Il est prévu dans la loi une exception au droit en quelque sorte ?
C’est un peu ça, oui.

À Bétharram, où des violences ont perduré pendant des années, les enfants étaient livrés à eux-mêmes, il n’y avait personne au sein de l’établissement pour les aider. L’institution judiciaire ne devrait-elle pas inventer un outil qui permette de venir en aide à ces enfants ?
Les outils existent. Toute personne peut faire un signalement auprès du procureur de la République ou auprès d’un juge des enfants, pas seulement un adulte. Et à partir de là, la procédure judiciaire va s’enclencher. Mais la véritable difficulté, pour moi, c’est l’information. Est-ce que tout le monde est informé que ces mécanismes existent ? C’est plutôt un problème d’information et de formation. Lorsqu’il y a un dysfonctionnement dans un établissement d’Éducation nationale, les mécanismes existent pour intervenir, sanctionner, protéger les enfants. C’est également le rôle du Parquet mineur d’intervenir rapidement dès qu’il a l’information. Pour moi, c’est la communication, l’échange d’information et la formation des personnels d’éducation au signalement, à ce qu’est la justice. Ce n’est pas un problème de personne, mais celui d’adapter l’évolution de la justice dans une institution dont la fonction première est d’éduquer – ou d’instruire, c’est un autre débat – mais pas de juger.
Mais précisément : un drame à la rentrée 2025 pointe un problème de communication au sein de l’Éducation nationale. Selon la FSU-SNUipp, principal syndicat du primaire, ce serait une des causes du suicide de Caroline Grandjean, cette directrice d’école que sa hiérarchie n’aurait pas assez protégée du harcèlement qu’elle subissait. Le fonctionnement vertical que vous décrivez pourrait aussi s’appliquer aux enseignants. Ne faudrait-il pas un outil de médiation, au moins ?
Les médiateurs existent. Ils peuvent faire des médiations enfants/enfants ou enfants/adultes/équipes éducatives. Aussi, dans la lutte contre le harcèlement scolaire, pour essayer de faire parler de potentiels victimes et de faire remonter les informations. Pour libérer la parole.
L’Éducation est le seul ministère à être qualifié de « nationale » dans son nom. Comme le parti politique qui ne cesse de progresser. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Là-dessus, je n’ai pas d’opinion à exprimer. Je vous laisse ce commentaire.
Propos recueillis le 4/09/2025
Légendes
– Photos d’illustration