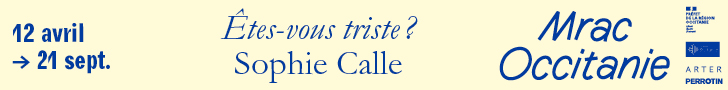La nuit commence à tomber sur le nouveau grand quartier de Port-Marianne à Montpellier. Allumage automatisé des luminaires de rue. Entre chien et loup, des responsables d’associations du quartier entreprennent une visite. Ils sont accompagnés d’Émilie Cabello, l’élue municipale responsable du secteur. Également de Damien Guiraudie, en charge de la stratégie lumière pour la métropole de Montpellier. Et de l’élu correspondant, le vert Bruno Paternot, vice-président chargé de « l’esthétique lumineuse et qualité de l’environnement visuel ».
D’un œil neuf, incisif et inspiré
Un rien baroque, cette dénomination avait d’abord fait sourire dans le monde culturel montpelliérain, comme un brin décalée pour le comédien de profession qu’est Bruno Paternot. Il réplique : « Puisqu’il s’agit de rendre moins dure la vie des gens, je reste persuadé que le souci de la beauté aidera à sauver le monde. » Et moins lyrique : « L’éclairage public ? Voilà un rare sujet où écologie rime directement avec économie. »
Retour à la visite de terrain. Souvent, les habitants vont en apprendre aux responsables. C’est aussi le but. Ici, un passage entre deux édifices résidentiels. Deux lampadaires. Sont-ils bien nécessaires, les halls des immeubles se situant en façade ? Réponse immédiate des connaisseurs du terrain : « Il y a un gros lieu d’attraction de loisirs un peu plus loin, le Marché du Lez. Et ceux qui en reviennent pour prendre le tramway empruntent ce passage. Après quoi, passé minuit, on n’y voit jamais plus personne. »
Dans le groupe, tout le monde est acquis au souci des économies d’énergie. « Est-il pertinent d’éclairer de la même manière entre 1h et 5h dans la nuit, comme on le fait entre 19h et 22h ? » pointe l’élue conseillère de secteur. La « marche sensible » se poursuit. Elle porte bien son nom. La banalité de l’éclairage public devient un livre ouvert, qu’il s’agit de feuilleter, d’un œil neuf, incisif et inspiré. On apprend à apprécier les variations entre chaleurs de lumières, plus ou moins chargées d’infrarouge ou d’ultraviolet, allant du chatoiement ambré orange au blanc très cru.

Dangerosité perçue
L’élu artiste et vert en est convaincu : « La sécurité ne provient pas à tout coup de l’éclairage le plus puissant possible ; mais plutôt d’une modulation la plus régulière possible. » Les ruptures marquantes d’intensité sur un parcours sont stressantes, tandis qu’une continuité apaisée serait rassurante. Parmi toutes les concertations entreprises, des panels spécifiquement féminins ont été constitués pour des explorations nocturnes.
Où l’on constate, par exemple derrière la gare, que la lumière ne doit pas être rabattue au simple rang d’un ustensile, mais abordée en lien avec des délaissés urbains, des anfractuosités, des dégagements incertains, des végétalisations mal pensées, et autres combinaisons multifactorielles qui déterminent la dangerosité perçue plus que réelle des espaces publics. Car les statistiques sont formelles et nient cette relation de cause à effet. Mais rien n’y fait : on aura toujours peur dans le noir.
Retour en visite à Port-Marianne. On passe devant des halls de résidence si puissamment illuminés qu’ils concurrencent l’éclairage sur le trottoir. « Et cela à toute heure, contrairement à la réglementation. Sans parler de la facture. Il faudrait alerter le syndic. » Sourires. À deux pas, on longe le Lez, petit fleuve méditerranéen qui borde le quartier. Sur la promenade tout le long, tous les luminaires, leur modèle, leur emplacement, l’orientation de leur faisceau lumineux ont été choisis et, de fait, éloignés de façon que la rive proprement dite, sa végétation laissée brute et le cours d’eau lui-même soient, au plus possible, baignés d’obscurité. Il en va du respect des espèces qui y nichent. Leur repos. Leur reproduction. Cela en pleine ville.
Faire « moins, mieux, merveilleux »
« Cette question des conflits d’usage entre résidents, visiteurs, activités professionnelles, faune animale, végétation naturelle ou jardinée, est complexe à arbitrer », souligne Bruno Paternot. « Et c’est donc passionnant. » Tous les partenaires parlent d’un travail de dentelle, par type de voie, ou d’activité humaine. Les chercheurs à la rescousse ? Axée sur la ville durable, l’université Gustave Eiffel sélectionne Montpellier pour son grand projet de recherche LUNNE (« La lumière, la nuit, nuit à l’environnement »). L’anthropologue Chris Blache appelle à « faire de l’acupuncture avec la lumière ».
L’architecte Daniel Andersch, président de la maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée, évoque la grande mutation sociétale en cours à propos de la lumière. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, elle symbolisa une idée de progrès, entre philosophie et esthétique. Au XIXe, la révolution industrielle – l’invention de l’ampoule – en marque le triomphe technique : la généralisation de la lumière artificielle signifie la maîtrise gagnée du temps. Le XXe siècle en consacre le triomphe, parallèlement à la société de consommation. Vitrine plein pot.
Bruno Paternot y rattache « l’éclairage public partout, tout le temps, le plus fort possible ». Enfin, Daniel Andersch en vient à notre jeune XXIe siècle, tout en transition : « Conduire la lumière, gérer les flux, qui sont aussi des flux de densité humaine. » Et nouvelle traduction de l’élu en termes d’éclairage public : « Éclairer juste, où il faut, quand il faut, en fonction des usages. » Tout en ménageant ses effets esthétiques : faire « moins, mieux, merveilleux ».
Des mesures radicales
Mais rien d’hurluberlu dans ces formules : « La chose a été prise très au sérieux quand, en 2021, les factures d’électricité des collectivités grimpaient de 75 %. » L’éclairage public représente un dixième de la consommation d’électricité du pays. Pas une paille. Des mesures radicales sont prises. Plus aucune augmentation du nombre de points lumineux, quelle que soit l’expansion urbaine. Ils resteront 800 000 sur l’agglomération de Montpellier, quand ils avaient augmenté de 30 % pour la seule décennie 90. Passage au LED de l’intégralité du parc : objectif à atteindre d’ici fin 2026. Ce seul changement de matériel, dorénavant beaucoup plus durable, se traduit par une baisse immédiate de consommation proche des 70 %. Suppression de l’éclairage des grands axes d’entrée de ville.
Et dès 22 heures, quand l’organisme humain sécrète la mélatonine, hormone de l’endormissement, tout l’éclairage montpelliérain baisse uniformément de 50 %. « À vrai dire, il faut vraiment y assister en étant averti pour s’en rendre compte », assure Damien Guiraudie, chargé de stratégie lumière par l’agglomération. Au total, celle-ci tend à une division par deux de sa consommation sur une décennie. Et Daniel Andersch n’a pas peur de suggérer, au nom de nouvelles quêtes d’harmonie « que quelque chose vienne indiquer que l’heure est peut-être venue d’aller se coucher. »
À cinquante kilomètres de Montpellier existe la réserve nocturne des Cévennes, où l’on peut se souvenir que trois mille étoiles s’offrent à l’observation des plus beaux ciels des plus belles nuits. De quoi rêver quand on sait que dans nos villes, on en était parvenu à devoir se contenter d’une vingtaine, plein d’éclairage dans la vue. Une grande misère dans la nuit.

Nîmes en habits de lumière
Arriver à Nîmes, de nuit par le train, c’est comme effectuer une entrée en scène. Depuis une dizaine d’années, les allées Feuchères, puis leur débouché sur l’esplanade Charles de Gaulle et la place des arènes, ont été somptueusement habillées d’une scénographie lumineuse. Huit hectares d’un seul tenant ont été traités par l’agence lyonnaise Les éclairagistes associés. Laurent Fachard y a orchestré la déambulation piétonne comme l’écoulement permanent de l’eau, les retraits végétalisés comme la contemplation du patrimoine antique monumentalisé. Impactant autant que raffiné, héritier des grandes visées modernisatrices du maire Jean Bousquet, porté par la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco avec Jean-Paul Fournier, ce projet maximalise une exigence d’élégance urbaine.
Légendes :
1 – Bassin Jacques Cœur, 22h30, à Montpellier. Est-il pertinent d’éclairer de la même manière entre 1h et 5h dans la nuit ?
2 – Rue de Raguse, l’éclairage au sol n’est plus qu’un vestige d’un passé pas si lointain.
3 – Les allées Feuchères, puis leur débouché sur l’esplanade Charles de Gaulle et la place des arènes, ont été somptueusement habillées