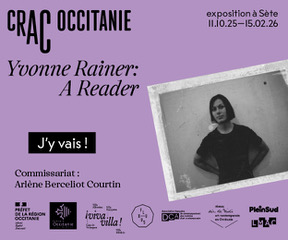La rétrospective Courbet en 2008, en partenariat avec le musée d’Orsay et le Metropolitan Museum ; Odilon Redon en 2011 ; l’exceptionnelle Caravage en collaboration avec Toulouse en 2012 ; Frédéric Bazille en 2016 ; Picasso en 2018 ; Germaine Richier en 2023… Et Soulages, bien sûr, en 1999, 2019/20 et jusqu’au 4 janvier 2026. À chaque fois, un événement. De là à permettre à Michel Hilaire une nomination à la tête du musée du Louvre ? À mi-carrière, il s’en est fallu de peu. Fin septembre, il a rembobiné le film pour artdeville.
Cette dernière exposition, Soulages – La rencontre dont vous êtes le commissaire, semble une exposition signature, commémorative de vos propres rencontres avec Montpellier, Soulages, d’autres… ?
Ce n’est pas faux. Ce n’est pas une exposition bouquet final de feu d’artifice, mais c’est un peu une manière de clore une très grande série de grandes expositions à Montpellier qui ont été la marque de fabrique de ce musée depuis que je l’ai pris en main et depuis qu’il a été rénové. Et en effet, les expositions que j’ai pu faire à Montpellier ont toujours été des rencontres naturelles. Il y a toujours eu, à un moment, une rencontre avec tous les partenaires, les artistes, les sujets qui sont arrivés presque naturellement, à chaque fois à point nommé. Et ça m’étonne moi-même. Cette exposition de 2025 arrive d’ailleurs pour les 20 ans de la donation de Soulages. Le moment était venu de mettre en perspective la collection du musée avec d’autres œuvres de Soulages, d’autres artistes.
C’est aussi par votre rencontre avec Fabre, en quelque sorte, lorsque vous étiez pensionnaire à la Villa Médicis, que vous est venue l’envie de devenir conservateur à Montpellier ?
Oui ! Quand j’y étais de 1987 à 1989, je suis au festival des Deux Mondes à Spoleto, un festival lyrique assez beau, en juillet. Une exposition François-Xavier Fabre avait été montée. Le musée de Montpellier avait prêté massivement les tableaux, les dessins… Le fait de voir cette exposition dédiée à cet artiste en Italie où il a passé plus de trente ans – c’était Fabre dans son milieu naturel puisque toutes les œuvres avaient été créées en Italie ; tout était là – je me suis dit « tiens, il y a quand même cette collection très italienne, très marquée par la Toscane, à Montpellier. » Ce musée, je le connaissais déjà, je l’avais vu adolescent ; il était un peu endormi. Quand Georges Frèche [maire de Montpellier à l’époque – NDLR] a voulu nommer un conservateur, je me suis porté candidat.
Ce fut ensuite la rencontre avec Soulages…
Je connaissais bien, à Paris, Michel Laclotte, directeur du Louvre et un ami personnel de Soulages depuis les années 50. Quand il a su que je partais à Montpellier, il m’a dit « la première chose que vous devez faire, Michel, c’est rencontrer Pierre Soulages, à Sète avec Colette [sa femme – NDLR], puisqu’ils passent l’été là-bas ». Soulages est un peu déçu par Montpellier qui n’a jamais rien fait pour lui, qui ne lui a jamais rien acheté. La rénovation de 1979-80 pour lui a été un massacre complet. Il y avait un désamour de Soulages avec Montpellier, et Michel Laclotte sous-entendait que si j’allais voir Soulages, je devrais changer les choses.

Comment avez-vous procédé ?
La première grande exposition que j’ai amenée dans mes bagages à Montpellier, c’était une exposition sur le grand siècle, la peinture française du XVIIe siècle. Il y avait une salle Latour, le maître de la lumière, les bougies, ce clair-obscur très particulier… Et Soulages est venu à mon invitation visiter l’exposition. Ça a été ma première rencontre avec lui. Il connaissait très bien Georges de la Tour, le XVIIe siècle, etc. À partir de là, une relation s’est créée. Je suis allé régulièrement voir les Soulages à Sète. Je leur ai dit que j’étais venu à Montpellier aussi pour rénover ce musée, l’agrandir. Que j’avais un projet derrière la tête. Soulages n’a fait que m’encourager, bien sûr. Il était très heureux que je puisse changer les choses. Et après cette rencontre magnifique, je me suis dit qu’il fallait concrétiser par des actes. Malgré la notoriété de Soulages, il paraissait incroyable que la Ville de Montpellier ne lui ait jamais acheté d’œuvre.
Il fallait réparer l’erreur, en quelque sorte ?
Voilà. Je suis donc allé à Paris dans l’atelier de Soulages avec l’adjoint de la Culture de l’époque, Yves Larbiou – qui, je dois dire, m’a beaucoup soutenu. Là, j’ai réalisé mon premier achat de deux magnifiques outrenoirs de 96, qui sont dans les salles permanentes du dernier étage, en pleine lumière. En 1999, j’ai monté une grande exposition des œuvres récentes de Soulages au pavillon du musée Fabre, qui était à ce moment-là la galerie d’exposition du musée [actuel pavillon populaire – NDLR]. C’était une manière de lui dire « Regardez, non seulement je vous achète, mais je vous montre ».
La rencontre avec le public montpelliérain…
C’est vrai. Il a été très très heureux de ce projet. On commençait à faire les études préliminaires pour le projet de rénovation du musée. Frèche lui a même proposé de lui construire un musée monographique dans un terrain qui serait aujourd’hui la mairie de Montpellier. J’étais présent et Soulages lui a dit : « Non, je veux des salles qui terminent le musée Fabre. Le musée Fabre, c’est le musée de ma jeunesse. Je l’ai découvert en 1941, quand je suis arrivé à Montpellier, que j’ai fréquenté l’école des Beaux-Arts et j’ai admiré cette collection des Courbet, Zurbarán, Delacroix… Ça me fait vraiment plaisir d’être dans ce musée. » Alors évidemment, il n’y avait pas de place. Frèche lui a dit : « OK, d’accord, on va aller au musée voir ce qu’on peut faire. » Il y avait une aile arrière qui avait été détruite dans les débuts des années 60 et il était très facile de la reconstruire. Ainsi, dans le programme des architectes, il y eut l’obligation de concevoir des salles pour Soulages, en pleine lumière (lire encadré). Et tout cela s’est fait en relation étroite avec l’équipe Brochet-Nebout et moi. Et Soulages, de son vivant ; il en a été très honoré. En retour, il a donné vingt toiles et dix dépôts, et la donation s’est concrétisée en 2005.

La rencontre avec Frèche a évidemment compté pour beaucoup…
Oui. J’ai eu la chance d’avoir un maire qui avait une ambition politique. Alors qu’il avait soutenu la musique, la danse, le patrimoine, il avait envie que le musée ne soit plus en décalage. Il a senti que je pouvais réaliser un grand projet. J’étais là pour ça ; il m’a laissé faire.
Sur la fin, le personnage de Frèche n’était plus exactement le même qu’au début.
Non. Mais c’était fait ! On a lancé le projet en 1999-2000, le concours en 2001, le déménagement, l’inauguration en 2007 et donc, sur la fin, le musée Fabre existait. Tout était fait en 2005, en réalité.
Votre statut de fonctionnaire d’État vous préservait aussi des turpitudes de la politique locale !
Tout à fait. C’est vrai que j’ai toujours gardé une certaine distance, j’ai toujours été au service de Montpellier, mais soumis à une forme de réserve républicaine.
Lorsque le projet polémique de musée de la France en Algérie a été proposé par Frèche, j’imagine que votre sérénité a tout de même été chahutée ?
Ah, mais je n’en avais pas du tout la charge. Je n’ai pas du tout été impliqué dans ce musée, pas du tout.
Mais depuis, le don de Raymond Depardon au musée Fabre – un « coup de main » de la part de l’artiste pour alimenter le fonds destiné à ce musée – a fait de vous un acteur.
Cela m’a fait acteur, oui et non. D’abord, il n’y a pas que des clichés qui concernent l’Algérie, il y a aussi toute la ruralité, l’Hérault, les Cévennes… Depardon est un immense photographe qui a quand même des liens avec Montpellier. Quand on a un artiste de ce niveau qui s’intéresse à la collection, pourquoi faire la fine bouche ? Et c’est vrai que ça ouvrait aussi le musée vers d’autres perspectives, la photo, qui n’était pas du tout présente jusqu’ici.
L’œuvre de Buren, La portée, qui forme le parvis et l’entrée du musée Fabre, a été amputée de son extension vers l’esplanade dès sa création. Pour des questions budgétaires, officiellement. Il était question de la finir ultérieurement. N’avez-vous pas eu envie de le faire ?
J’en ai eu très envie à l’époque, avec Buren. Quand il a gagné ce concours, je le trouvais très beau parce que, d’abord, il n’était pas en élévation. Il avait gagné aussi pour ça. J’étais très contre le fait d’obstruer le parvis du musée avec des constructions, et plusieurs projets oblitéraient la pureté de cette façade classique.

La symbolique d’aller chercher les gens sur l’esplanade plutôt que simplement les accueillir sur le parvis était plus forte.
Voilà. Je l’ai un peu regretté en effet, parce qu’à l’époque, Buren m’avait montré la maquette et ça créait une perspective avec la Comédie. Ça amenait les gens naturellement vers le musée Fabre. Après, cette « portée » se désagrège au fur et à mesure qu’on traverse le bâtiment puisqu’elle disparaît avant les collections. Le coût n’était n’était pas énorme. Il fallait juste traverser la chaussée et aller un peu chercher sur le jardin.
Deux mouvements picturaux contemporains majeurs ont été créés dans l’Hérault, Supports/Surfaces et Figuration libre. L’art bourgeois, en quelque sorte, d’une part, et l’art populaire, d’autre part. Seul le premier fait partie des collections. N’avez-vous pas un regret pour le second ?
Non, pas du tout. Je pense qu’un musée a un projet scientifique à défendre. Et j’ai ouvert le musée Fabre à l’art contemporain, ce qui n’était pas le cas avant. Aujourd’hui, il y a plusieurs centaines d’œuvres, un fonds qui a été créé sur plusieurs décennies. Le grand mouvement qui a des liens forts avec le Midi, c’est Supports/Surfaces, dont la plupart des acteurs sont passés par l’école des Beaux-Arts, comme Viallat, Bioulès, Dezeuze… Je leur ai rendu hommage par des achats et des expositions, moyennes ou grandes, à chaque fois.
Mais Combas et Di Rosa sont aussi passés par les Beaux-Arts.
Ils sont passés par les Beaux-Arts, mais étaient défendus ailleurs, à Sète notamment. Et je pense qu’à un moment donné, dans un musée, il y a un problème de place.
Par contre, qu’ils soient présents dans la collection, finalement… D’une certaine manière, ils ont été les élèves des grands de Supports/Surfaces, avec qui ils ont d’excellents rapports d’ailleurs, Bioulès, Viallat… Ils peuvent tout à fait, dans les années futures, rentrer dans la collection. Ils auraient vraiment leur place.
La patte d’un conservateur, c’est de valoriser le fonds. Mais quelle est la vôtre ? Quels éléments tangibles vont-ils identifier votre travail au musée Fabre ? Les grandes expositions évidemment, mais quelles acquisitions ?
Oui, les grandes expositions d’abord, mais les grandes expositions découlent d’une politique d’achat, puisque tout ça procède d’un projet scientifique. Toutes les acquisitions passent devant un comité d’acquisition qui les valide. Et j’ai eu la chance pendant toute ma carrière d’avoir ces commissions deux fois par an, avec des spécialistes, des conservateurs, la DRAC, des conservateurs de Département, du Louvre, etc. Les acquisitions du musée Fabre, c’est presque 3 000 œuvres qui sont entrées, si on compte toutes les donations, les dessins, le fonds d’atelier de Vincent Bouilès, etc. Mais aussi des centaines d’œuvres depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui.
Les plus marquantes ?
Si on devait retenir les grands ensembles qui créent, je dirais une identité, mon identité, celle du musée Fabre, évidemment, et celle des conservateurs avec qui j’ai travaillé, c’est d’abord l’enrichissement des collections anciennes autour de la peinture française et italienne du XVIIe, XVIIIe. Le fonds est beaucoup plus riche et considérable aujourd’hui qu’il l’était il y a vingt-cinq ans.
Ensuite, le fonds néoclassique, puisque j’ai très fortement enrichi la personnalité même de Fabre, encore lacunaire dans son propre musée. Et ses contemporains : des noms importants comme Gauffier, Boilly, Gagneraux. Ensuite, autour du XIIe, c’est vraiment l’ensemble des Basile que j’ai sauvés de la dispersion, au moment où tous les tableaux partaient en Amérique en vente publique. Avec toutes les ventes et les négociations avec les héritiers, j’ai pu renforcer la présence de Basile à Montpellier et faire l’exposition avec le musée d’Orsay National Gallery de Washington, en 2016.
Bien évidemment, le fonds Richier que j’ai créé, là, de toutes pièces, parce qu’il n’y avait que deux pièces de Richier. Rendre hommage à cette femme sculpteur extraordinaire du XXe siècle qui était passée par l’école des Beaux-Arts de Montpellier était indispensable.
Et le Poussin ?
J’allais oublier ! La grande réalisation que j’ai eu la chance d’aboutir, c’est de réunir le Poussin [Vénus et Adonis de Nicolas Poussin, peint vers 1626, était séparé en deux parties, dont seule la partie droite était dans la collection du musée Fabre. L’autre a été retrouvée à New York – NDLR]. Je l’ai poursuivi pendant une quinzaine d’années avant de concrétiser l’achat. Et ça a été une opération nationale, puisque c’était un trésor classé, avec des sommes considérables : 1,9 million d’euros. La fondation d’entreprise que je venais de créer en 2010 y a fortement contribué. Les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi les fonds privés du mécénat national. Ce tableau aujourd’hui est un des grands chefs-d’œuvre anciens du musée Fabre.
Pierre Soulages – La rencontre, jusqu’au 4 janvier 2026 Musée Fabre – Montpellier
En pleine lumière ?
Éclairer les outrenoirs de Soulages n’est pas un choix anodin, ses œuvres jouant avec l’ambiance lumineuse. Le dossier de presse de l’exposition en cours jusqu’au 4 janvier 2026, l’explique : « L’architecture et la lumière : un choix radical. » Il semble toutefois que cet enjeu ne figurait pas dans le cahier des charges du concours architectural lors de l’agrandissement du musée Fabre, entre 2001 et 2007. L’artiste n’a découvert la maquette de « ses » salles qu’une fois le concours d’architecte gagné. La grande salle vitrée, notamment, où sont suspendus désormais cinq de ses chefs-d’œuvre – si essentielle et monumentale – Pierre Soulages ne l’a validée qu’après sa conception. Lorsque les architectes Brochet & Nebout lui ont soumis le projet, ils étaient fébriles, selon l’aveu à artdeville de Mme Laurence Laval, du cabinet d’architecte, lors de l’inauguration en 2007. Une remise en cause eût été, certes, problématique. Pour les salles 46, indique d’ailleurs le même dossier de presse, « un fort éclairage zénithal incorporé dans le plafond est complété, selon le désir du peintre, par une quarantaine de spots ».
« J’étais présent, témoigne Michel Hilaire, directeur du musée à l’époque. Ils lui avaient dit : « Si vous voulez mettre des œuvres de face sur câble, on peut prévoir telle surface, il fallait avoir à peu près les dimensions de la collection. Ensuite, il y avait la double paroi de verre pour les éclairer de face. Et c’est ce dispositif, effectivement, qui a été soumis à Soulages, qu’ils ont créé et conçu. Il y a eu des échanges, des discussions. Peut-être a-t-il un peu regardé la qualité du verre, parce qu’en fait il y a 70 centimètres entre les deux parois de verre ! »
Au musée Soulages de Rodez, inauguré en 2014, le choix du peintre a été au contraire d’occulter les fenêtres.
Légendes
Le peintre Pierre Soulages en compagnie de Michel Hilaire, en 2006, devant le tableau de Gustave Courbet, Bonjour Monsieur Courbet, initialement intitulé La Rencontre. © C. Marson/Montpellier3M
Michel Hilaire et Pierre Soulages dans la grande salle vitrée n° 47, lors de l’inauguration du nouveau musée Fabre, en 2007, avec Laurence Laval, du cabinet d’architecte Brochet & Nebout. © C. Marson/Montpellier3M
La portée, de Daniel Buren, fonde le parvis du musée Fabre depuis sa rénovation en 2007. Une œuvre partiellement tronquée, qui reste à finir. © C. Marson/Montpellier3M